Amitiés littéraires d’hier…
Michèle Causse et Katy Barasc écrivent. Voir plus bas.
Hommage à Raymond Besson: voir fin de la page.
Beauvoir, Sarraute, Genet, Sartre, Cocteau, Sachs, Françoise d’Eaubone, Michèle Causse, Thérèse Plantier… tous furent ses amis passionnels…
Simone de Beauvoir et Violette Leduc :
On pourrait aussi bien dire » Simone de Beauvoir et son ombre, Violette Leduc » (voir mon article in Vol. 13 archives de la Simone de Beauvoir society) Deux styles radicalement opposés, une fascination réciproque.
– Une correspondance bouleversante en témoigne : aussi entre une Violette éperdue d’admiration et une Simone de Beauvoir tendre et chaleureuse. Cette correspondance prend vie dans une excellente émission de France Culture : » paroles de l’intime » diffusée lors du festival d’Avignon en 1997. Elle est publiée par Carlo Jansiti. (rubrique La recherche)
– Sur leur relation d’amitié, déséquilibrée bien entendu, sur le rôle que joua Simone de Beauvoir dans la publication de l’oeuvre de Violette Leduc mais aussi dans la mise au monde de ses livres, sur ses encouragements, ses corrections voire ses suppressions, il y aurait trop à dire. Une amitié qui prendra fin à la mort de Violette Leduc, l’amitié de toute une vie de femme et de toute une vie d’écrivain.
» Nous portons le nom que nous méritons. Le mien est un coup de trique. Celui de Simone de Beauvoir est un attelage. Je séparerai jamais son prénom de son nom. Comment pourrais-je séparer l’azur du ciel… Je dis tout haut son prénom et son nom, je me promène dans un jardin à la française, je suis altière et distraite, je vais, entre les statues, avec mon mouchoir de dentelle, je n’élève pas la voix. Son prénom et son nom dans ma bouche, la pudique amande dans l’écorce « .
La Folie en Tête, éditions Gallimard, collection l’Imaginaire, p. 41.
Sartre et Violette Leduc :
» Pourquoi Sartre me fait-il souffrir » ?
Leduc rencontre Sartre, à plusieurs reprises : elle le voit à travers Simone de Beauvoir, secrètement jalouse de leur relation. Pourtant il l’accueille avec son amabilité habituelle, l’encourage dans son travail, la publie dans les Temps Modernes. Une crise éclate, lors de la parution des Séquestrés d’Altona, alors que Violette Leduc émerge à peine d’une grave dépression nerveuse.
Les Séquestrés d’Altona écrit et mis en scène en 1960, a pour protagoniste Franz, ancien nazi devenu fou. Violette s’identifie à Franz et accuse Sartre de s’être inspirée d’elle pour le rôle:
« Je ne suis pas un ancien officier caché par les siens. Je n’habite pas en Allemagne la plus petite chambre d’une propriété. Ce séquestré c’est moi, ai-je soutenu à Simone de Beauvoir. Pourquoi Sartre me fait-il souffrir? Pourquoi est-il venu voir dans un trou au plafond le spectacle de mes dépressions? Pourquoi Sartre m’utilise-t-il? Sartre me vise. Sartre ne me loupe pas. L’officier ne perdrait pas la raison si je n’existais pas. Mes malheurs sont dans le broyeur d’un homme de talent.
Simone de Beauvoir m’écoutait. Elle ne m’interrompait pas. plus qu’une politesse. Une compassion d’attentionnée. Son visage changeait, ses yeux s’éteignaient au fur et à mesure que je racontais. Je ne la persuadais pas : je l’attristais. Son intelligence, sa bonne volonté ne lui servaient à rien. Elle ne pouvait pas me rejoindre où j’étais.
– Ma pauvre Violette… a dit Simone de Beauvoir. » (La Chasse à l’amour, éditions Gallimard, collection N.R.F, page 77)
La collaboration de Violette Leduc avec Sartre est visible avec la publication dans Les Temps Modernes de nombreux extraits de ses oeuvres (voir la rubrique correspondante) : outre ce que nous pouvons considérer comme deux premiers états de certains épisodes de l’Affamée et de La Bâtarde, avec le célèbre passage intitulé » le Tailleur anguille « , de nombreux textes demeurent inédits en dehors de la revue.
Jean Genet, l’ami tourmenté.
La rencontre de Leduc et de Genet se fait par les œuvres : elle a lu Miracle de la Rose, lui l‘Asphyxie, lectures qui alimentent leur conversation lors de leur premier face-à_face, en 1946 :
– Si vous saviez comme j’ai aimé Miracle de la Rose… Je venais de sauter dans le feu. Je perdais la tête, je dansais dans les flammes :
– Harcamone, quand vous le libérez, quand il s’envole…
Harcamone, une sorte de grand pétale mythologique au-dessus des prisons… Je n’osais pas le lui dire, mes mains jointes l’exprimaient.
Il tapotait sa cigarette au bord de la soucoupe, il était consciencieux avec la cendre, elle ne devait pas tomber à côté…
– Sans blague ! Vous aimez mes livres… ?
Sans blague. Genet est charmant lorsqu’il doute. Sans blague. Voilà Genet sensible comme une feuille de peuplier.
(La Folie en Tête, Gallimard, folio, p. 178)
La critique littéraire a abusivement considéré longtemps Violette Leduc et Jean Genet comme des » jumeaux en écriture » : certes la thématique de l’homosexualité et leur écriture brillante et fiévreuse ont pu inciter à effectuer de telles comparaisons qui tournaient toujours d’ailleurs à l’avantage du » grand » Genet dont Leduc ne serait que la pâle imitatrice. Pourtant leurs points communs ont effectivement débouché sur une véritable amitié entre les deux écrivains : une réelle estime de la part de Genet et une admiration fervente de la part de Violette Leduc. Très vite pourtant leur relation va se dégrader, sans doute du fait des sentiments excessifs manifestés par cette dernière : on se souvient du récit qu’elle fait d’un dîner privé auquel elle convie Genet et de la façon dont, exaspéré par les attentions appuyées qu’elle lui témoigne, il quitte l’appartement avec fracas, après avoir tiré violemment la nappe de la table avec tout ce qui était disposé dessus…
Sur les échos entre les œuvres de Genet et de Leduc voir la thèse d’Elisabeth Seys : Violette Leduc, Jean Genet : poétique du désastre.
Leduc , Sarraute : Deux voix.
L’admiration de Violette Leduc pour Nathalie Sarraute, telle qu’on peut la percevoir dans La Folie en tête, dépasse celle qu’elle a pu ressentir pour tous les écrivains qu’elle a rencontrés dans sa vie, excepté peut-être celle qu’elle voue à Simone de Beauvoir :
« …Je le disais à Simone de Beauvoir : je préférais la tristesse, les tourments, les tortures, les abattements, les arrière-plans, les fluctuations, les harassements de Nathalie Sarraute à la robustesse physique et morale, aux clartés d’intelligence, aux ouvertures constructives de Colette Audry ».
Une telle fascination naît d’une identification implicite. L’auteur se reconnaît dans Nathalie Sarraute, comme dans un miroir rassurant, avec une profonde nuance de respect pour cette personnalité et pour son écriture. Pourtant, leur parentée n’est pas immédiatement visible dans leurs oeuvres, si différentes. L’oeuvre de Sarraute, jusqu’à Enfance, n’est pas autobiographique. Fondatrice du nouveau roman, en tant qu’écrivain et en tant que théoricienne, sa véritable recherche se fait dans l’aventure de la langue, transgressant et repoussant les limites des genres littéraires. Avec Sarraute le sujet entre en littérature, mais pas seulement le sujet personnel, le « je », mais un sujet au contraire si impersonnel qu’il bouleverse tout le rapport de l’énonciation au réel.
Jacques Guérin et Violette Leduc :
L’histoire d’un amour impossible, celui de l’écrivaine en quête de reconnaissance, en quête d’identité, en quête d’amour. Celui d’un riche industriel amateur de belles lettres qui compris très vite l’importance de l’oeuvre de son amie Violette, qui publia à son propre compte la partie censurée de Ravages : Thérèse et Isabelle. Un mécène généreux qui l’aida financièrement et affectivement une bonne partie de sa vie, au même titre que Simone de Beauvoir. La dédicace de l’Affamée est à Jacques : Violette écrira qu’elle a longtemps hésité entre lui et Simone de Beauvoir pour cette dédicace, puisque chaque mot de ce livre était écrit pour » elle « . Les sautes d’humeurs de Violette Leduc, peut-être aussi sa dépression dans les années 1950 éloignèrent peu à peu Jacques d’elle. La fin de La Folie en tête est l’émouvant témoignage du suicide d’une amitié…
En préparation: Jacques Guérin, de Carlo Jansiti.
Voici le témoignage de Carlo Jansiti :
« Jacques Guérin avait à l’époque quatre-vingt-quatre ans et cinquante-six ans nous séparaient (il est mort en 2000 presque centenaire). Il avait été l’homme que Violette Leduc avait « le plus aimé ». Elle le décrit dans son oeuvre avec une étonnante justesse. Par son physique et son tempérament, il était très proche du « Jacques » de « La Folie en tête ». C’était tout à fait grisant pour le jeune Italien que j’étais de rencontrer en chair et en os l’un des modèles principaux de Violette Leduc. J’éprouvais le curieux sentiment de toucher là, presque du doigt, la Littérature. Jacques Guérin impressionnait tout d’abord par son apparence. Il était grand, droit, avec un beau visage au front large et au regard bleu, à la fois perçant et flou derrière ses verres de myope. Rarement j’ai rencontré une personne de cet âge aussi débordante de santé, de vitalité, d’enthousiasme communicatifs. Doué d’une intelligence, d’une culture littéraire, d’un esprit critique hors du commun, et aussi d’une mémoire étonnante, il pouvait converser, ou plutôt monologuer, pendant huit heures de suite et dans un français admirable, comme on n’en parle plus aujourd’hui. C’était un homme du dix-huitième siècle né au début du vingtième. Son langage était incisif et suranné. C’était un conteur fabuleux. En l’écoutant, j’avais souvent l’impression d’être au théâtre. Il écrivait d’une façon tout aussi remarquable et j’ai souvent pensé qu’il était un écrivain virtuel. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il n’avait jamais songé à écrire. « Je ne sais pas ce que c’est que d’écrire, me répondit-il. Je ne prends pas part à la course. Je reste dans les tribunes. Je regarde. C’est tout. » Ses goûts littéraires étaient vastes, éclectiques. Il avait été l’un des premiers admirateurs et amis de Genet – qui lui dédia « Querelle de Brest » et lui présenta Violette Leduc – à une époque où celui-ci était encore un auteur marginal. J’ai fait de longs séjours chez lui à la campagne. C’est avec lui que j’appris le français (j’avais décidé d’écrire ma biographie dans la même langue que celle de mon sujet). Il m’a aidé dans mon enquête en retrouvant parfois des adresses, des numéros de téléphone, en rédigeant des lettres de recommandation. Il a été un médiateur et un maître. C’est grâce à l’entremise de Jacques Guérin que la nièce de l’écrivain, Claude Dehous, voulut bien m’ouvrir ses archives. » in : Violette Leduc, les coulisses d’une biographie.Notice nécrologique du FIGARO Vendredi 18 août 2000 (lire):
Maurice Sachs. L’histoire d’un malentendu.
Sur la personnalité sulfureuse de cet homme de lettres mort dans de tristes circonstances, il faut lire la biographie de Henri Raczymow, Maurice Sachs ou les travaux forcés de la frivolité editions Gallimard, NRF 1988.
Un très beau chapitre est consacré aux relations entre Maurice Sachs et Violette Leduc.
Raczymov écrit : » Pour parler de Sachs (…) nous l’avons fait à travers le regard privilégié de Violette Leduc. C’était inévitable, mais c’était aussi une chance. Nul n’a su mieux qu’elle parler de Maurice Sachs. Nul ne l’a aimé comme elle. A la façon d’un être masochiste, certes, mais qu’importe ? Il nous reste un regard, un regard d’écrivain, le regard d’une femme qui devient écrivain dans le temps même où elle vit avec Sachs, et qui le devient à travers l’amour malheureux qu’elle lui voue. Rien d’étonnant alors à ce qu’elle en parle d’une admirable façon. «
Dans La Bâtarde, souvenons-nous de cet épisode étrange :
Je reçois une enveloppe avec le cachet de la poste de Rouen. Qui pouvait m’écrire avec cette écriture d’enfant ? Je décachetai, je trouvai une seconde enveloppe sans adresse. Maurice… Il m’écrivait ceci sur une petite feuille de papier :
» Mon amour,
Tu me dis que tu es enceinte et que cela ne va pas tout droit pour toi. Veux-tu que je vienne te voir, te sentirais-tu mieux si j’étais près de toi ? Réponds-moi. Je t’embrasse ma chérie
Maurice « .
Triste stratagème pour que Violette, alors réfugiée dans le village normand d’Anceins ( !) lui envoie un certificat médical. Nous sommes en pleine occupation. Sachs s’est compromis. Il a besoin de rentrer. Le film VIOLETTE de Martin Provost met en scène cet épisode étrange.
Jean Cocteau et Violette Leduc :
Leduc admire Cocteau, sans éprouver pour lui la passion qu’elle éprouve pour Genet ou Jacques Guérin qui fut son mécène littéraire. Elle croise Cocteau dans sa jeunesse aux éditions Plon, elle est dans la période de sa maturité invitée chez lui à Milly et connaît l’honneur mêlé d’un soupçon d’excitation de dormir dans la chambre de Jean Marais en l’absence de celui-ci. Dans La Chasse à l’amour elle raconte ses promenades avec Jean et toute sa » bande « , et on la voit improviser dans les jardins de la villa de courtes saynètes…Cocteau, ce grand dénicheur de talents, conservera pour Violette une estime intellectuelle solide. (lien: site officiel Jean Cocteau)
Françoise d’Eaubonne et Violette Leduc :
Françoise d’Eaubonne, écrivaine et militante féministe, amie de Violette Leduc, est morte le 3 août 2005 à l’âge de 85 ans.
Née le 12 mars 1920 à Toulouse, elle est le troisième enfant d’un anarchiste chrétien, le comte Etienne d’Eaubonne, originaire de Bretagne, et d’une fille de chef carliste, Rosita Martinez Franco. Françoise d’Eaubonne décrit, avec une crudité peu habituelle pour l’époque, sa vie d’adolescente sous l’occupation, dans Chienne de jeunesse (Julliard, 1966). Après un court passage dans les rangs du Parti Communiste, à la Libération, elle milite ardemment contre la guerre d’Algérie et figure, à ce titre, parmi les signataires du Manifeste des 121, paru en septembre 1960, qui proclamait le droit à l’insoumission des conscrits. La lecture du livre de Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, publié en 1949, la bouleverse et la révèle au combat féministe. C’est Françoise d’Eaubonne qui, séduite par l’écriture de Leduc, présente celle-ci à Simone de Beauvoir en 1945. Cofondatrice du Mouvement de Libération des Femmes (M.L.F), dans le courant des années 1960, elle lance, en 1972, avec l’écrivain et journaliste Guy Hocquenghem, le Front homosexuel d’action révolutionnaire (F.H.A.R). Dans les années 1970 elle publie ses essais les plus remarqués parmi lesquels Les Femmes avant le Patriarcat (Payot, 1976) et Le Féminisme ou la mort (Pierre Horay, 1974). Mère de deux enfants, Françoise d’Eaubonne annonce, en 1976, dans les colonnes du quotidien Libération, son mariage avec le détenu Pierre Sanna, condamné à vingt ans de prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Amie de Michel Foucault, elle milite pour l’abolition de la peine de mort. En 1978 elle crée le mouvement Ecologie-Féminisme qui aura peu d’échos en France. Il aura plus de succès en Australie et aux Etats-Unis, où une chaire a été crée sur cette question. Faite Chevalière des Arts et Lettres, elle finit ses jours dans une maison de retraite pour artistes, près de Montparnasse.
(renseignements biographiques tirés de la notice nécrologique de Catherine Simon, Le Monde, 6 août 2005)
Parmi ses ouvrages :
La liseuse et la lyre (Belles Lettres, 1997 );
Féminin et philosophie (L’Harmattan 1997) ;
Les scandaleuses (P. Lebaud, 1990) ;
Les grandes aventurières (P. Lebaud 1990) ;
Une femme nommée Castor (Encre, 1986).
Seppuku ou le roman à clefs (La Cerisaie 2003)
Une Rose pour Violette… Lire le texte publié par Jean-Claude Arrougé sur son blog.
Dans sa communication publiée dans les actes du colloque Violette Leduc par Paul Renard et Michèle Hecquet, (1998), Françoise d’Eaubonne raconte sa rencontre avec Violette Leduc, en 1966, et les rapports intellectuels chaleureux qui les unirent ensuite. Un regard de romancière est toujours précieux pour connaître autrement, différemment, un auteur qui a la particularité de n’être pas seulement un » objet d’étude » universitaire, mais une personnalité encore vivante par la modernité de ses écrits, et proche de nous.
La beauté et l’audace de sa toilette, la grâce d’une silhouette qui fit de grands couturiers lui prêter des robes, la justesse des détails de la parure, tous ces dons se retrouvent dans la réussite de son écriture.( …) On nous a tué Violette Leduc à force de ne pas l’aimer. Le moment est venu de rendre les chaussures de cette morte éclatantes comme des soleils, conclut Françoise d’Eaubonne, faisant allusion à un merveilleux épisode de la nouvelle : La Vieille fille et le mort.
La Plume et le baillon
Dans cet ouvrage publié en 2000, Françoise d’Eaubonne aborde trois écrivains victimes de la censure : Violette Leduc, Nicolas Genka et Jean Sénac. Pour l’auteure, Violette est victime de la double « injure » : l’injure faite d’abord à la femme- du fait de sa prétendue laideur- et à la lesbienne, étiquette dont on l’affuble volontiers du moment qu’il s’agit de réduire ses œuvres à un érotisme dérangeant. Elle rappelle quels furent les aléas de la réception de cette œuvre forte et méconnue et lui oppose l’extraordinaire succès qu’elle connaît aujourd’hui… surtout à l’étranger !Personne moins qu’elle eût pu dire : » Je gémis sans m’affliger. » … Son rêve juvénile n’était que de devenir » statue sur son socle » pour aboutir au constat à demi masochiste d’être » limace sur son fumier » (incipit de La Bâtarde). Quant à sa geinte, elle constituait le rythme de son travail, la trame la plus serrée de son chant, ce » cante hondo » qui est son cantique de la frustration. Et pourtant, si son lamento s’est transformé en nourriture spirituelle d’un lectorat posthume, l’immense intérêt que rencontre aujourd’hui cette œuvre en porte témoignage. Sans doute est-ce surtout à l’étranger ? » Nul n’est prophète en son pays « , dit-on. (Et le dicton s’avère encore plus juste quand on le met au féminin !) » .pp. 25-26, éditions l’esprit frappeur, N°70.
Michèle Causse, la « narrée navrée »
« UNE VIE A L’OEUVRE »: découvrez le site consacré à l’écrivaine!
Lisez le livre co-écrit avec Katy Barasc: Requiem pour Il et Elle.
Journée d’études à Arras: lire l’allocution de Michèle Causse.
Michèle Causse (29 juillet 1936- 29 juillet 2010) a vingt-deux ans lorsqu’elle fait la connaissance de Violette Leduc en 1958. La jeune lectrice enthousiaste avait, dès la parution de l’Asphyxie , puis de l’Affamée, mesuré l’importance de l’écrivaine. A l’occasion de la parution de Ravages , dont elle sait que l’ouvrage a été censuré et amputé de la partie Thérèse et Isabelle , elle se décide à écrire à Violette Leduc. Suivent cinq ans de relations intellectuelles et amicales houleuses, faites d’estime réciproque mais aussi d’exaspération. Violette, on le sait, n’a pas un caractère facile : c’est un euphémisme ! Michèle Causse fait le récit et l’analyse de cette relation dans son texte « la narrée navrée » écrit à l’occasion de la journée d’étude consacrée au centenaire de la naissance de Violette Leduc .
L’autre aspect de cette relation est que celle-ci est inscrite et « littérarisée » dans La Chasse à l’amour . Lorsqu’en 1973 Michèle Causse revient à Paris, après un séjour de dix ans à Rome, qu’elle découvre ce que Violette a dit de sa rencontre avec la jeune lectrice, il est trop tard pour lui demander des comptes : Violette Leduc est morte l’année précédente. Du coup l’écrit devient trahison, comme c’est le cas pour la plupart de ce que l’on appelle « les mémoires ». La mémoire de Michèle Causse, elle, ne se retrouve pas dans la narration de Violette Leduc. Mais toute œuvre est fiction de soi, en même temps que fiction des autres : Michèle Causse le sait et son article « la narrée navrée » est aussi une façon de rendre hommage à l’écrivaine qui l’a trahie.
En 1999 paraissait dans la revue Roman 20-50 un entretien passionnant entre Michèle Causse et Françoise Armengaud: « Violette, dans son écriture et sa thématique, réunissait les deux pôles de mon existence : le goût du texte et le dire du sexe. » L’écriture, l’homosexualité, Beauvoir, la censure… Tout cela évoquée par celle qui, à vingt ans, a connu Violette.

lire: Miche`le Causse_F.Armengaud – entretien sur Violette Leduc
Thérèse Plantier: « la walkyrie du Ventoux »
Née à Nîmes, en 1911, Thérèse Plantier fut longtemps enseignante à Marseille, puis retirée à Faucon dans le Vaucluse. Elle commença à publier, en 1945, vivant passionnément le surréalisme. En 1964, Thérèse Plantier répondit avec délectation à l’enquête de la revue La Brèche sur les « représentations érotiques ». André Breton la complimenta pour sa réponse. Il avait d’ailleurs décelé en elle : « une violente volonté de vertige ». Plantier rétorqua : Je ne m’exprime qu’en surréaliste. Le temps n’est pas venu où l’on puisse s’exprimer autrement. Thérèse Plantier participa aux réunions surréalistes, au café La Promenade de Vénus et fut invitée chez André Breton, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot). Thérèse Plantier prit ensuite ses distances, non avec Breton, mais avec son entourage, pour se rapprocher davantage du Pont de l’Epée de Guy Chambelland et de « la Poésie pour vivre » de Jean Breton.
Liée d’une forte amitié à Simone de Beauvoir et à Violette Leduc (à qui elle écrira : « Vous écrivez comme Van Gogh peint »), Thérèse Plantier entreprit très tôt, comme l’a écrit son ami Jocelyne Curtil, une étude critique du discours des hommes dans différents domaines : philosophie, anthropologie, ethnologie, sociologie… lire la suite de la biographie de Christophe Dauphin dans la revue Recours au poème.
Publication récente:
et… le témoignage de jean-Claude Arrougé qui a connu Violette et Thérèse à Faucon. Portrait de Thérèse:
Thérèse Plantier ? « Elle était ardente quand elle était jeune », me confie Thérese Beaumont, cette merveilleuse octogénéraire, personnage poétique dont parle Violette dans La Bâtarde et sous le prénom d’Apoline dans la Chasse à l’amour. Les Beaumont, fils et belle-fille, évoquent aussi Violette qu’ils ont vue arriver bien pauvre dans le village – et qui venait souvent quémander une poignée de cerises ou un vieux poireau. Elle était maintenant tout à fait adoptée par les habitants du village, qui avaient fini par accepter ses tenues excentriques, son franc-parler… Lire la suite

Monique Lange: l’amie fidèle.
Ecrivaine, scénariste. Elle est née dans une famille juive comprenant Henri Bergson et Emmanuel Berl. Elle a passé son enfance en Indochine. Elle a travaillé à « La revue du cinéma » et aux « Temps modernes », elle a été éditrice chez Gallimard. Elle a été mariée à l’écrivain Juan Goytisolo.
Elle a écrit des scénarios pour le cinéma : Vanina Vanini, pour Roberto Rossellinii, La Prisonniere pour Henri- Georges Clouzot, La Truite pour Joseph Losey. Elle a écrit deux biographies : » Jean Cocteau, prince sans royaume » (1989) et « Histoire de Piaf « (1988) et des romans : Les Poissons-chats (1959); Les Platanes (1960).
 Sa fille Carole Achache, auteure de Fille de…
Sa fille Carole Achache, auteure de Fille de…
L’écrivaine Carole Achache, dont nous avons le regret d’annoncer le décès en 2016, a connu Violette Leduc lorsqu’elle était enfant au début des années 60. Elle est la fille de son amie intime, Monique Lange. Carole témoigne, ce vendredi 17 octobre, lors de la table ronde consacrée aux paroles d’écrivains, de son rapport personnel à Violette. Avec beaucoup de verve et d’humour, elle se souvient de son effroi et de sa fascination lorsqu’elle vit pour la première fois cette « bonne femme », une Violette totalement déjantée, brisée par la dépression, une Violette telle qu’elle se présente elle-même dans la Folie en tête et La Chasse à l’Amour. Carole l’évoque avec une émotion contenue tout en suggérant les liens ténus entre l’influence cette « figure » et sa propre carrière d’écrivaine…
René de Ceccatty dans un article du Monde en 2011 rappelle, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage que Carole Achache consacre à sa mère, Fille de :
Violette Leduc, dans La Chasse à l’amour (Gallimard, 1973), avait tracé d’elle un portrait à la fois admiratif, magnifique et cruel. « Monique déplace beaucoup d’air pour ceux qu’elle aime. Elle apparaît, elle remue l’atmosphère. Elle vous accueille, c’est une bouilloire en ébullition dont le couvercle est prêt à sauter. Monique arrive, elle lime vos épines, elle émousse la pointe de vos clous. Elle arrondit. C’est une réconciliation avant son bonjour. »
Carole Achache qui, enfant, a connu Violette Leduc, répond par un portrait de l’auteur de La Bâtarde (Gallimard, 1964), à sa manière. Elle raconte des souvenirs où Violette n’était guère à son avantage : jérémiades, minauderies, manipulations, insistances, harcèlements, démonstrations pénibles. Mais Carole Achache révise son jugement sévère de petite fille agacée par l’invasion d’une névrosée histrionique. Elle lit l’oeuvre de Violette Leduc et « jubile ». « Je rencontre un grand écrivain. Pour moi, c’était une cinglée, un auteur secondaire. Elle est remarquable. Violette se ré approprie sa vie. Témoin d’une époque et de sa folie, mais aussi de sa relation maladive avec sa mère. »
Lire le résumé de l’intervention au colloque 2014. Raymond Besson, décédé en février 2012, était un fervent admirateur de Violette leduc. Il a participé à la journée d’études à Arras en 2007. La Voix du Nord consacre un article à cet homme sincère à l’occasion de la diffusion du documentaire sur Violette Leduc.
Raymond Besson, décédé en février 2012, était un fervent admirateur de Violette leduc. Il a participé à la journée d’études à Arras en 2007. La Voix du Nord consacre un article à cet homme sincère à l’occasion de la diffusion du documentaire sur Violette Leduc.























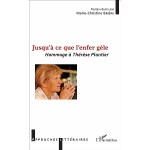

Excellent, j’ai eu un énorme plaisir à découvrir ces différents témoignages autour de Violette Leduc. Actuellement, je lis « Thérèse et Isabelle » avec volupté : c’est une écriture absolument somptueuse. Simone de Beauvoir avait raison de l’encourager à écrire…
J’ai beaucoup apprécié tous ces témoignages, qui se complètent et s’intègrent les uns aux autres, sans réduire l’écrivain, l’écrivaine, à simplement ceci ou cela. J’y reviendrai et en parlerai autour de moi. En attendant, un très grand merci!
Violette et Lorca une effusion d’images. Exubérance. Profusion et luxuriance. Ce qu’elle nomme « baroque ». La respiration, la cadence de ses phrases »haletantes » comme disait Simone de Beauvoir. Le goût des reprises, des répétitions. Parallélismes, progressions montantes et envoûtantes.
A la fois musicienne et peintre. Tendre et cruelle. Mélange exquis, mais vrai. « Un cri dans la journée est un soleil qu’on fait souffrir. Un cri, la nuit, est un éclair, il éventre les ténèbres. »
Préciosité et ésotérisme. « Préciosité de ratée », dit-elle dans la Chasse à l’Amour. La sincérité déroutante jamais impudique, toujours impudique, de quelqu’un qui dit les choses et qui pour cela prend des risques… lire le texte entier sur la page « Autour de Violette aujourd’hui »
Nice blog thanks for postinng